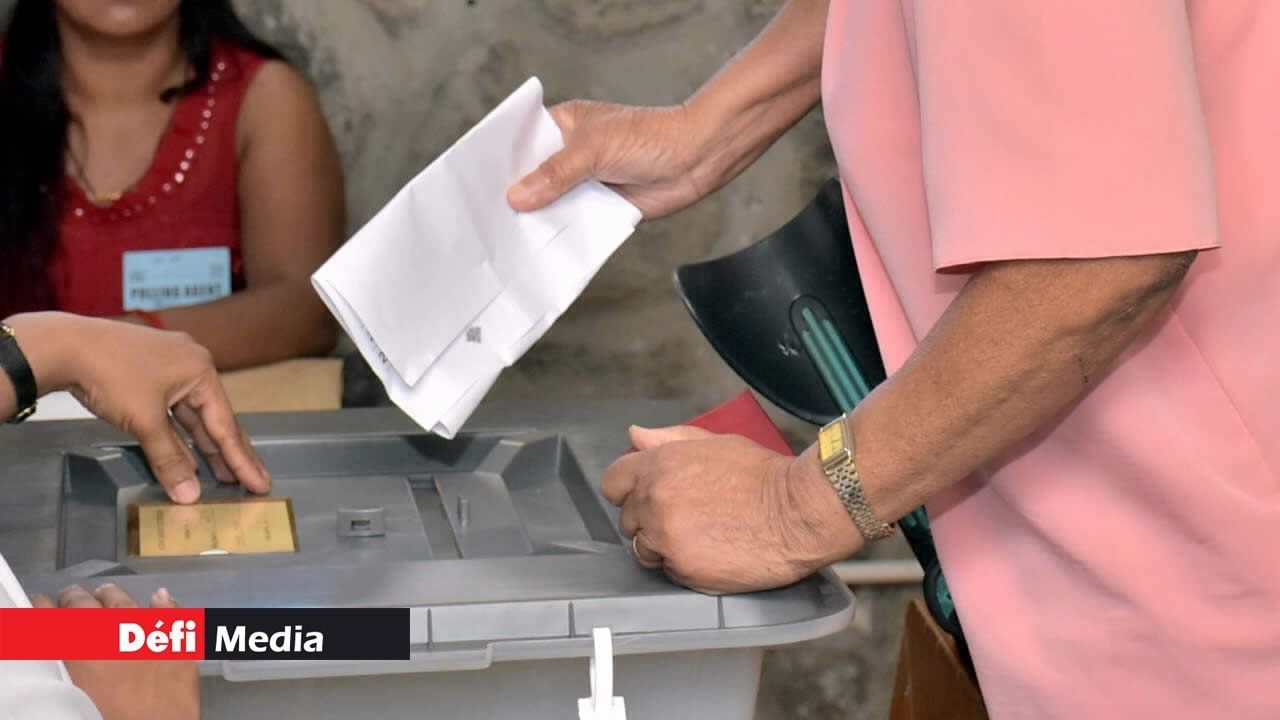
Les élections municipales du dimanche 4 mai ont été marquées par une participation historiquement faible : seuls 26,27 % des électeurs se sont déplacés aux urnes. Un chiffre préoccupant, en recul par rapport aux 35 % enregistrés lors des municipales de 2015 et aux 44 % en 2012.
Le désintérêt grandissant pour les élections locales s’explique par une campagne terne, sans idées nouvelles ni mobilisation. L’absence de partis majeurs comme le MSM et le PMSD, ainsi que la perception qu’elles comptent moins que les législatives y contribuent aussi. Face à cette désaffection, la question du vote obligatoire refait surface.
Plusieurs pays ont déjà instauré l’obligation de voter, chacun avec ses modalités. Par exemple, en Belgique, où le vote est obligatoire depuis 1893, les électeurs peuvent être sanctionnés par des amendes, voire radiés des registres électoraux pour dix ans s’ils s’abstiennent à plusieurs reprises sans justification. En Grèce, l’abstention peut compliquer l’obtention de documents administratifs comme le passeport ou le permis de conduire.
En Australie, où le vote est obligatoire depuis 1924, les contrevenants s’exposent à des amendes, voire à des travaux d’intérêt général, à la saisie de biens, voire à de courtes peines de prison en cas de récidive. En Bolivie, ne pas voter peut même entraîner le gel du salaire. Ces exemples illustrent une perception du vote, considéré non plus uniquement comme un droit, mais aussi comme un devoir civique.
Pour l’observateur politique Jocelyn Chan Low, imposer une amende à ceux qui s’abstiennent serait irréaliste dans un pays comme Maurice.
« Si 10 % de l’électorat ne vote pas, cela représenterait des milliers de personnes à identifier et à sanctionner », explique-t-il. Pour lui, l’abstention massive est le symptôme d’un dysfonctionnement institutionnel profond : perte de confiance, sentiment que rien ne change quel que soit le vainqueur, ou encore inadéquation entre l’offre politique et les attentes citoyennes. Il va même plus loin en affirmant que l’abstention peut être perçue comme une forme d’action politique.
Neena Ramdenee, de Linion Moris, estime que la réforme des administrations locales aurait dû précéder la tenue de ces élections. Elle déplore le fait que « les municipalités manquent toujours cruellement d’autonomie ». Pour elle, obliger les citoyens à voter ferait du vote une contrainte plutôt qu’un choix éclairé. Elle plaide pour la reconnaissance du vote blanc, comme expression d’un refus de l’offre politique sans pour autant s’abstenir. Sur le plan des sanctions, elle propose un système de type bonus-malus, semblable à celui appliqué en assurance automobile : « Plus vous participez aux scrutins, plus vous bénéficiez d’avantages ; dans le cas contraire, vous en perdez ». Le journaliste Bernard Saminaden insiste sur l’importance de la responsabilité citoyenne : « L’État investit massivement dans les services publics. Il est donc légitime d’attendre des citoyens qu’ils participent activement à la vie démocratique ». Il souligne que l’annonce, lors du meeting du 1er mai, d’un budget d’austérité à venir a pu démobiliser certains électeurs.
Selon lui, la participation donne aussi au citoyen la légitimité de critiquer : « On ne peut pas vouloir tous les avantages de l’État et refuser de s’impliquer. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ». Il s’interroge : « Que dirait un citoyen à qui l’on refuserait un service municipal, comme le ramassage de ses ordures, pour ne pas avoir accompli son devoir civique ? »
Vers une réforme nécessaire
Entre l’idée de contraindre, celle d’inciter, ou encore celle de réformer profondément le système, les pistes sont nombreuses. Ce débat autour du vote obligatoire pourrait bien nourrir les réflexions à venir sur la réforme électorale, ou à tout le moins sur celle des administrations locales.
Alwin Sungeelee
 J'aime
J'aime














