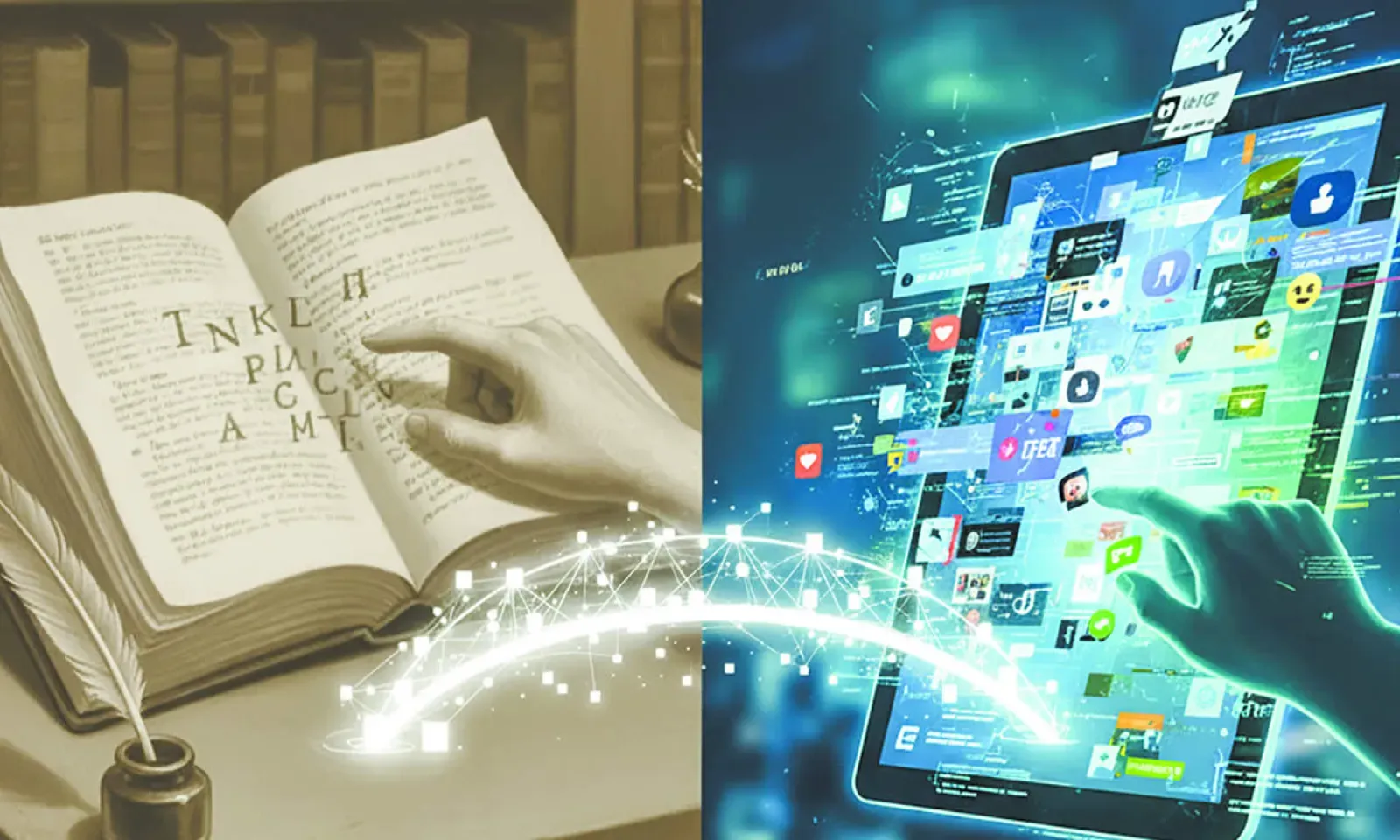
Lire ne suffit plus. Dans un monde où tout se digitalise, certains savent déchiffrer un texte sur papier, mais se perdent face aux écrans, aux formulaires en ligne ou aux informations sur les réseaux sociaux. L’illettrisme a pris un nouveau visage. La Journée mondiale de l’alphabétisation, observée le
8 septembre, est l’occasion de repenser ce qu’« être alphabétisé » signifie au XXIe siècle.
À l’ère numérique, que signifie vraiment « être alphabétisé » ? Pour le comprendre, il faut d’abord interroger la notion d’alphabétisation.
« L’alphabétisation, c’est littéralement le processus par lequel on apprend à écrire l’alphabet et les différents symboles que l’on utilise pour représenter les sons », explique Guilhem Florigny, linguiste et chargé de cours à l’Université de Maurice. Ce processus, souligne-t-il, commence toujours sur papier.

Chaque symbole ou lettre correspond normalement à un son. Sauf que « le passage de l’oral à l’écrit à Maurice est particulièrement compliqué, car il implique plusieurs langues », indique Guilhem Florigny. Les enfants jonglent entre le français et l’anglais à l’écrit, parfois avec le kreol morisien ou une langue asiatique. Cela complique l’apprentissage des correspondances lettres-sons, « d’autant que les langues qu’ils apprennent à l’écrit ne sont pas celles qu’ils parlent tous les jours », souligne le linguiste, rappelant que la langue maternelle de plus de 90 % des Mauriciens est le kreol morisien.
Résultat : certains élèves peinent à faire le lien entre lettres et sons. Ils sont confrontés à des sons absents de leur quotidien et doivent apprendre des symboles qui ne leur sont pas familiers. Cette situation, selon Guilhem Florigny, contredit les recommandations de l’UNESCO, qui insiste sur l’importance d’un apprentissage initial dans la langue maternelle, tant pour les élèves que pour les enseignants.
L’avènement des écrans et du numérique ajoute un autre défi. « Beaucoup de jeunes ont perdu l’habitude d’écrire à la main », observe-t-il. Les SMS, les chats et les réseaux sociaux favorisent abréviations, écriture phonétique, emojis. Cette écriture rapide, adaptée aux contraintes techniques, s’éloigne de l’orthographe officielle du français ou de l’anglais, laissant des traces sur la capacité à structurer sa pensée à l’écrit, tout en ayant un impact cognitif significatif.
Selon Guilhem Florigny, ces lacunes ont des conséquences importantes : « Environ un enfant sur cinq, parfois un sur trois, a des difficultés à lire et à écrire. Ils ne font pas le lien entre lettres et sons. » Sans ces bases, leur progression à l’école est limitée et l’accès au numérique devient plus complexe. « Sans capacité de lecture et d’écriture, ils développent des stratégies alternatives, comme l’usage d’images. Mais cela les prive d’une partie importante de l’information, principalement écrite dans nos sociétés modernes », prévient Guilhem Florigny.
Consolider les bases

Didier Samfat, expert en cybersécurité, abonde dans le même sens. L’UNESCO, dans son Global Education Monitoring Report de 2023, rappelle que la littératie traditionnelle demeure « la porte d’entrée vers toutes les autres compétences », y compris les compétences numériques. Ainsi, pour l’expert, il faut d’abord consolider les bases : lire avec ses yeux, écrire avec ses mains, développer les facultés neuronales et cognitives qui en découlent.
« Il s’agit avant tout de développer son savoir-faire en matière de compréhension, d’analyse, de créativité et d’esprit critique. »
Pour lui, ce n’est pas un hasard si de nombreux grands patrons de la Tech aux États-Unis (notamment chez Google, Apple ou Meta) interdisent les écrans et les réseaux sociaux à leurs propres enfants lors des repas ou après une certaine heure et privilégient des écoles privées où l’accent est mis sur le développement cognitif, la lecture et l’esprit critique. « Cela montre que même ceux qui construisent le monde numérique savent que les bases analogiques sont indispensables. »
Didier Samfat cite la recherche en neurosciences, notamment Maryanne Wolf, Reader, Come Home (2018), qui montre que la lecture longue sur papier stimule la concentration, la mémoire et l’esprit critique d’une manière qu’aucun écran ne remplace.
« Sans cette formation de base, les enfants risquent d’être de bons consommateurs de contenus numériques, mais de faibles penseurs critiques. »
À ce propos, Guilhem Florigny fait remarquer qu’avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), un autre défi apparaît : celui de la mémorisation et de la capacité à réfléchir. « Pour la première fois dans l’histoire, le quotient intellectuel des jeunes générations est plus bas que celui des anciennes, selon les études qui ont été effectuées. »
Ce paradoxe s’explique, selon lui, par le fait que les jeunes savent où chercher l’information, mais ne la transforment pas toujours en connaissance acquise. « Ce ne sont pas des savoirs maîtrisés, ce qui affecte la mémoire et la capacité à approfondir la compréhension. » Les générations actuelles développent donc des compétences différentes de celles de leurs aînés : elles savent accomplir certaines tâches nouvelles, mais disposent de moins de connaissances pures, précise le linguiste.
« Esprits paresseux »
Didier Samfat rejoint l’analyse de Guilhem Florigny, citant notamment l’OCDE. « L’étude PISA 2022 sur la compréhension en lecture numérique a montré que de nombreux adolescents savent naviguer sur les réseaux sociaux, mais échouent à évaluer la crédibilité d’une source en ligne. »
Pour la première fois dans l’histoire, le quotient intellectuel des jeunes générations est plus bas que celui des anciennes»
Cependant, il nuance : l’IA ne rend pas idiot, c’est son mauvais usage qui fabrique des « esprits paresseux ». « L’IA a embrasé le monde sans véritables garde-fous. C’est un outil formidable qui, bien utilisé, peut améliorer la productivité, la pertinence et la qualité du travail. Mais elle comporte aussi des risques majeurs si on s’y abandonne sans esprit critique. »
D’autant que l’IA n’est pas infaillible. Il évoque une étude de l’Université de Hong Kong (2023) qui a montré que seulement 60 % des réponses produites par des outils d’IA générative étaient exactes. « Pourtant, de nombreux étudiants ne prennent pas le temps de vérifier et livrent des travaux truffés d’erreurs. Cela nourrit un double danger : une dépendance cognitive, où l’élève ne sait plus penser par lui-même, et une société future où les professionnels reproduisent mécaniquement du contenu sans recul critique. »
Dans son ouvrage La fabrique du crétin digital, le neuropsychologue Michel Desmurget explique qu’une surexposition aux outils numériques appauvrit l’attention et affaiblit les capacités de raisonnement. « Tôt ou tard, cela se voit. Lors d’un entretien d’embauche, son incapacité à raisonner, à argumenter ou à résoudre un problème concret sera immédiatement décelée. »
Ainsi, pour Didier Samfat, l’IA ne rend pas forcément la société plus « bête ». Mais si elle est mal utilisée, elle risque de former des générations qui savent « produire » du texte mais qui ne savent plus réfléchir en profondeur. Il insiste : la question n’est pas de bannir l’IA, mais de l’encadrer « et surtout d’enseigner aux jeunes à l’utiliser comme un outil de réflexion et non comme une béquille intellectuelle ».
Alphabétisation double
C’est pourquoi il estime qu’inclure trop vite la littératie numérique dans les indicateurs d’alphabétisation pourrait réduire artificiellement le taux global d’alphabétisation, et mettre l’accent sur la maîtrise des écrans au détriment de la lecture en profondeur. « Il est dangereux de fusionner trop vite deux réalités différentes : la capacité à lire un livre, comprendre, analyser, en tirer ses propres conclusions, et l’agilité à naviguer en ligne. Nous restons avant tout des êtres analogiques qui évoluent dans un monde concret et physique. Se couper trop tôt de ce monde, et plonger directement dans le numérique, n’est pas sans risque, surtout pour les enfants », insiste l’expert en cybersécurité. Il précise : « On ne peut pas bâtir une maison numérique sur du sable. »
Cela dit, il ne s’agit pas de négliger les compétences numériques.
« Mais il faut clarifier de quoi on parle. Savoir remplir un formulaire en ligne, télécharger une application, reconnaître un site officiel d’une arnaque, distinguer une information fiable d’une fausse. »
Il préconise un programme structuré en trois étapes : consolider l’alphabétisation classique en renforçant la lecture, la maîtrise de la grammaire, de l’orthographe, l’analyse de textes littéraires et scientifiques.
’objectif, dit-il, est de développer des capacités de raisonnement et d’écriture sans l’appui systématique d’outils numériques ou d’IA correctrices.
Ensuite, introduire une formation de base à la cybersécurité en sensibilisant tous les publics – enfants, adultes, seniors – aux risques de phishing, usurpation d’identité, arnaques en ligne, mais aussi à la protection des données personnelles. « L’Union européenne, avec son Digital Competence Framework, insiste sur la nécessité de développer ces compétences de manière transversale, comme une ‘nouvelle grammaire’ du numérique. »
Enfin, former à l’usage des services numériques et applications pour apprendre à utiliser concrètement les outils numériques utiles dans la vie quotidienne : démarches administratives, services bancaires, communication professionnelle. « Mais toujours en gardant à l’esprit que ces outils ne doivent pas remplacer les facultés critiques, mais les prolonger. » Il le résume ainsi : « Lire et écrire forment l’esprit, la cybersécurité le protège, et le numérique l’ouvre sur le monde. »
Didier Samfat insiste : « L’alphabétisation du XXIe siècle est double : analogique, pour développer la pensée critique et la créativité, et numérique, pour ne pas être exclu d’une société où tout se dématérialise ». Il met en garde : « Si nous brûlons les étapes, nous risquons de former une génération qui sait cliquer et scroller rapidement, mais ne sait plus penser. Par exemple, même des jeunes, très à l’aise sur TikTok, peuvent être “analphabètes” quand il s’agit de lire un contrat en ligne, vérifier une info, ou rédiger un mail professionnel. »
Pour la société mauricienne de demain, c’est un vrai danger, prévient Didier Samfat. « Un cerveau formaté par les algorithmes, sans recul critique, est un citoyen plus fragile face aux manipulations en ligne et surtout aux enjeux du monde du travail. »








