
- Quand l’emprise fait régner la loi du silence
- L’insidieuse normalisation des comportements toxiques dans la société mauricienne
Le féminicide de Danaa Malabar révèle la détresse des femmes enfermées dans des relations toxiques. Peur, honte, dépendance : chaque jour efface un peu plus leur liberté. Pourquoi restent-elles ? Comment leur tendre la main pour briser ce cycle infernal ?
«J’avais peur de respirer trop fort. » La trentenaire, qui témoigne sous couvert d’anonymat, décrit ainsi les années passées auprès d’un homme qui ne levait jamais la main sur elle, mais dont les mots « faisaient plus mal que des coups ». « J’étais dans une prison sans barreaux. Je vivais dans la peur de mal faire, de mal parler, de le contrarier. Je n’existais plus. »
Cette autre femme, enceinte et âgée de 33 ans, se cachait, elle, dans une armoire pendant que son compagnon la cherchait avec un couteau, ses enfants réfugiés chez des voisins… Rachel, elle, proche de la quarantaine, dormait dans un lit avec ses enfants tandis que son conjoint partageait la chambre d’à côté avec sa maîtresse, sous le même toit. « Je me suis sentie humiliée et trahie », dit-elle.
Pourquoi sont-elles restées ? Parfois des années, malgré les coups, les insultes, l’infidélité affichée. La question, souvent posée avec incompréhension voire reproche, mérite qu’on s’y attarde. Car derrière l’apparente passivité se cache un mécanisme redoutable : l’emprise.
Les débuts sont souvent trompeurs. Les premières semaines ressemblent à un conte : attention, affection, promesses d’un amour sincère. Puis les fissures apparaissent – un mot blessant, un ton dur, une crise imprévisible. La victime s’accroche à l’image du début, celle de l’homme aimant, convaincue qu’il « reviendra comme avant ». Et sans s’en rendre compte, elle entre dans un engrenage de peur et de justification.
« J’étais persuadée que si je faisais plus d’efforts, il redeviendrait celui du début. J’excusais tout », confie une de nos interlocutrices « Je disais qu’il était fatigué, stressé, qu’il avait eu une enfance difficile. Je croyais que c’était à moi de l’aider. » Son regard s’assombrit quand elle évoque les années de silence. « Il me disait que sans lui, je n’étais rien. Et je l’ai cru. Je me suis coupée de mes amis, de ma famille. Je n’étais plus moi-même. »
De son côté, Rachel, qui a grandi dans un centre pour adolescents en difficulté et survécu à des agressions qui ont marqué son corps, pensait avoir trouvé l’amour et la stabilité. « Il a fait semblant de m’aimer et par la suite tout est parti à la dérive. » Les coups – même enceinte –, les insultes, les infidélités se sont multipliés. Mais elle « tenait, tenait » en se répétant qu’avec le temps, « peut-être il pourrait changer ».
Les témoignages convergent sur plusieurs signes caractéristiques. D’abord, le contrôle progressif : surveillance des sorties, des communications, des réseaux sociaux, isolement de l’entourage. Pour cette femme, mère de deux enfants issue d’une précédente union, le contrôle s’est installé insidieusement. « Il n’aimait pas quand je sortais. Il voulait faire des appels vidéo pour voir où j’étais. Il n’aimait pas que je prenne des photos ni que je les publie sur Facebook. »
Puis sont venues les violences physiques, toujours suivies d’excuses. « Surtout quand il buvait, il m’insultait et me frappait. Et le lendemain, il présentait ses excuses. » Un cycle qui entretient l’espoir. « Je l’aimais aussi. Il connaissait mes points faibles. Je pardonnais toujours, et je restais. »
L’alternance violence-tendresse joue un rôle crucial. Les excuses après chaque accès de violence entretiennent l’espoir d’un retour à la période idyllique. L’agresseur trouve des justifications à ses actes, rend la victime responsable de son comportement. « Au début, je me taisais et restais soumise. »
Puis la dévalorisation systématique. « Il me reprochait une infidélité inexistante, ce qui me faisait douter de moi-même », raconte l’une. « Il me disait que sans lui, je n’étais rien », répète une autre.
Rachel a connu l’isolement le plus total. Sans le soutien de sa famille, à qui elle avait bien essayé de se confier mais qui ne lui avait opposé que des reproches, elle s’est retrouvée seule. « Il m’a fait comprendre que j’étais sous son pied, que je n’avais aucune famille. » D’épouse, elle est devenue « la bonne à tout faire de la maison », son rôle réduit à s’occuper des enfants, faire le ménage et préparer à manger, pendant que son compagnon « menait la belle vie en dehors ». Pourtant, Rachel est restée. Pour ses enfants, dit-elle. Et parce qu’elle ne voyait pas d’autre solution.
La difficulté de partir
Partir ne se résume pas à fermer une porte. C’est affronter des peurs multiples : la peur de la solitude, du regard des autres, du lendemain. C’est remettre en question toute une vie construite autour d’un mensonge. C’est aussi affronter la honte, ce sentiment diffus qui dit à la victime qu’elle a « échoué ». Cette honte, souvent, la retient plus solidement que la peur.
« Je suis restée à cause de mes enfants, de ma dépendance financière envers lui, du manque de soutien familial et, surtout, parce que je n’avais nulle part où aller », explique une victime. « La peur me retenait également. »
La peur finit par tout envahir, confirme Rachel. « Je n’avais pas le droit de parler. Quand il me battait, je ne pouvais rien faire parce qu’il était plus fort que moi », témoigne-t-elle. Elle craignait d’être frappée « deux fois plus » si elle rendait les coups.
Le départ survient souvent grâce à un élément déclencheur. Pour l’une, ce sont ses enfants. « J’ai finalement décidé de partir grâce à l’insistance de mes enfants, qui ne pouvaient plus supporter cette situation. Malgré les menaces et ma peur, le courage de mes enfants m’a donné la force nécessaire. »
Pour celle de 33 ans, c’est l’escalade de la violence qui a tout précipité. Cachée dans une armoire, ses enfants chez des voisins, elle a attendu que la police intervienne. « Sans les policiers, je ne serais peut-être plus là aujourd’hui. »
Le jour du départ laisse un « mélange de soulagement et de vide », confie une victime. « J’ai eu l’impression de respirer pour la première fois depuis longtemps, mais j’avais peur aussi. J’avais perdu tous mes repères. »
« Aujourd’hui, je n’ai plus peur et je vis sans crainte », témoigne une autre. « Mon conseil à une femme qui traverse ce que j'ai vécu est d'oser tout quitter, d'avoir le courage et la foi de devenir autonome financièrement. »
Rachel a tenté de partir à deux reprises, se réfugiant dans un centre pour femmes en détresse. À chaque fois, « sur les promesses d’un changement de comportement » de son compagnon, elle est retournée habiter avec lui. Les promesses « se sont vite envolées ». Ce n’est qu’à la troisième tentative qu’elle a rompu définitivement.
Aujourd’hui installée dans un centre pour femmes en détresse, Rachel affirme avoir « retrouvé le sourire ». « Je sens que je suis débarrassée d’un poids et j’ai retrouvé ma sérénité. »
Elle ne vit désormais « que pour l’avenir de ses enfants, de qui elle puise sa force et son courage ». Elle ne se soucie plus du regard de la société, « car elle sait ce qu’elle a enduré et personne n’a été là quand elle avait besoin d’aide et de soutien ».
Son message est clair : « Ne pas accepter la violence mais chercher leur sécurité et leur paix intérieure. » Elle estime « qu’il faudrait davantage de structures pour accueillir les femmes victimes de violence et que des solutions durables soient trouvées ». Elle déplore également le manque de soutien pour les jeunes ayant vécu dans un foyer d’accueil qui, « arrivés à l’âge de 18 ans, se retrouvent livrés à eux-mêmes » - une vulnérabilité qui peut les exposer à des relations toxiques.
Questions à…Fatimah Ghanty, psychologue : «À Maurice, beaucoup de comportements toxiques sont normalisés»
 Derrière chaque histoire de violence, il y a souvent un long processus d’emprise, d’isolement et de culpabilité qui enferme la victime dans un cycle invisible. La psychologue Fatimah Ghanty décrypte les signes avant-coureurs, les mécanismes de contrôle et les obstacles à la reconstruction.
Derrière chaque histoire de violence, il y a souvent un long processus d’emprise, d’isolement et de culpabilité qui enferme la victime dans un cycle invisible. La psychologue Fatimah Ghanty décrypte les signes avant-coureurs, les mécanismes de contrôle et les obstacles à la reconstruction.
Dans votre pratique, comment définissez-vous une relation toxique ou une dynamique d’emprise ?
Dans ma pratique à Maurice, je définis une relation toxique ou une dynamique d’emprise comme une relation où l’un des partenaires prend peu à peu le contrôle sur l’autre - sur sa manière de penser, d’agir, de s’habiller ou même de ressentir. C’est une forme de domination psychologique et émotionnelle qui peut paraître subtile au début, mais qui finit par étouffer complètement l’autre personne. L’amour devient alors un outil de manipulation.
Ce qui est difficile, c’est que dans notre société mauricienne, beaucoup de comportements toxiques sont encore normalisés. Par exemple, la jalousie excessive ou le contrôle sont souvent perçus comme des « preuves d’amour ». Certaines femmes me disent : « Me li zis posesif, li kontan mwa. » Alors que derrière ce « li kontan mwa », il y a parfois une emprise, une peur ou une dépendance affective.
L’emprise, c’est quand la personne commence à douter d’elle-même, à s’excuser tout le temps, à marcher sur des œufs. Elle n’a plus confiance en son jugement, elle cherche constamment à plaire pour éviter le conflit.
Quels sont les signes précoces qui devraient alerter une personne avant même que la violence physique ne s’installe ?
Avant même qu’il y ait de la violence physique, il y a souvent beaucoup de signaux d’alerte qui passent inaperçus, surtout dans notre contexte mauricien où certaines attitudes sont encore banalisées. Les premiers signes sont presque toujours psychologiques et émotionnels. Par exemple, quand une personne commence à vous isoler doucement : elle critique vos ami(es), votre famille, ou fait en sorte que vous sortiez moins. C’est une façon subtile de vous couper de votre soutien extérieur.
Ensuite, il y a le contrôle : sur la façon de s’habiller, sur ce qu’on publie sur les réseaux, sur qui on parle. Beaucoup de gens à Maurice confondent ça avec de la protection — on dit souvent « mo zis pa oule dimounn get twa » — mais c’est déjà une forme de possessivité qui n’a rien à voir avec l’amour. Et à Maurice, on doit encore apprendre à reconnaître que la violence n’est pas seulement quand « li tap twa ». Elle commence bien avant, dans les mots, les silences, les regards…
On ne peut pas ‘forcer quelqu’un à quitter une relation’, surtout si elle se sent piégée ou dépendante»
L’emprise psychologique se construit souvent de manière insidieuse. Pouvez-vous nous expliquer comment elle s’installe ?
L’emprise psychologique est très subtile au départ, et c’est ce qui la rend particulièrement dangereuse. Elle ne commence jamais brusquement par la violence ; elle s’installe progressivement, souvent masquée par des gestes qui semblent attentionnés ou par de petites critiques « pour notre bien ». Par exemple, une personne peut d’abord vous complimenter, puis vous corriger constamment, vous faire douter de vos choix ou de vos perceptions.
Petit à petit, elle vous apprend à remettre en question votre propre jugement et à dépendre de son approbation pour tout. L’emprise s’installe donc en douceur : isolement progressif, critique constante, manipulation des émotions, alternance entre affection et rejet, jusqu’à ce que la personne se sente complètement perdue et dépourvue de confiance en elle. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de reconnaître qu’on est pris dans cette dynamique, car elle devient « normale » aux yeux de la victime.
Quels types de comportements ou de discours peuvent masquer une forme de contrôle ou de manipulation ?
Il y a le chantage émotionnel, avec des phrases du type « si tu m’aimais vraiment, tu ferais ça » ou « tu ne me respectes pas » qui sont très courantes. Elles font culpabiliser la personne et l’amènent à changer son comportement pour éviter la colère ou le rejet. Il y a aussi les manipulations subtiles dans le quotidien : exagérer des situations, jouer sur la peur ou la honte, ou faire semblant d’être la « victime » pour inverser les rôles.
Ces comportements peuvent paraître anodins au départ, mais cumulés, ils instaurent un contrôle psychologique très puissant. Si quelqu’un vous fait douter de vous-même, vous culpabilise sans raison ou vous isole de vos soutiens, il ne s’agit pas de « petits conflits de couple », mais de signaux de manipulation ou de contrôle. L’amour ne devrait jamais fonctionner sur la peur ou la culpabilité.
Quelles attitudes récurrentes distinguez-vous chez les personnes qui exercent la violence émotionnelle ?
Tout d’abord, il y a la critique constante. Ces personnes dévalorisent régulièrement l’autre, remettent en question ses choix, ses goûts, son apparence ou même son intelligence. À Maurice, beaucoup de victimes minimisent ces critiques, pensant que « c’est juste sa manière de parler », alors que c’est un outil puissant de contrôle.
Ensuite, il y a la manipulation des émotions : culpabilisation, chantage affectif, menaces voilées ou crises de colère disproportionnées pour obtenir ce qu’elles veulent. Elles alternent souvent affection et rejet, ce qui crée une dépendance émotionnelle chez la victime.
Du côté des victimes, pourquoi ne se reconnaissent-elles pas toujours comme telles ?
D’abord, il y a la normalisation. Beaucoup de victimes pensent que ce qu’elles vivent est normal dans un couple. À Maurice, on entend souvent : « Tou dimounn dan so lakaz li koumsa » ou « mo bizin tolere, se mo devwar dan maryaz. » Elles comparent leur situation à celle des autres et se disent que la critique ou le contrôle font partie de l’amour. L’emprise émotionnelle crée une confusion et une perte de confiance en soi. La victime doute de ses perceptions et de son jugement. Elle commence à se demander si « mo zis pe reazir tro » ou « mo pa kapav konpran li bien ».
Du coup, peut-on parler d’une normalisation de la violence dans la société ?
Oui, tout à fait. Et cela se voit à deux niveaux : dans certaines relations et dans la société en général. Dans certaines relations, surtout celles où l’emprise s’installe progressivement, les comportements toxiques sont perçus comme normaux. Ces petites violences psychologiques sont acceptées comme faisant partie de l’amour ou de la vie de couple.
Au niveau sociétal, il y a aussi une certaine tolérance implicite envers la violence, notamment parce que notre culture valorise la discrétion et le maintien de l’image de la famille. Les phrases que l’on entend souvent, comme : « Pa fer lavwa tro for dan lakaz » montrent que la société minimise ou excuse parfois des comportements qui ne devraient pas être tolérés.
Cette normalisation est dangereuse car elle rend les victimes plus vulnérables et les empêche de demander de l’aide. Beaucoup pensent que leurs souffrances sont normales ou qu’elles doivent juste endurer, alors qu’il est possible de vivre dans une relation respectueuse et équilibrée.
On doit encore apprendre à reconnaître que la violence n’est pas seulement quand ‘li tap twa’. Elle commence bien avant, dans les mots, les silences, les regards…»
Partir demande-t-il seulement du courage ?
C’est vrai, beaucoup de gens disent que partir demande du courage, et il y a du vrai là-dedans. Mais ce que l’on oublie souvent, c’est que quitter une relation toxique ne dépend pas seulement du courage : cela demande aussi des ressources émotionnelles et matérielles importantes.
Émotionnellement, la personne a souvent été fragilisée par l’emprise, la critique constante et la manipulation. Elle a besoin de soutien pour reconstruire sa confiance en elle, comprendre ce qu’elle a vécu et apprendre à poser des limites. À Maurice, on entend souvent : « Mo pa pou kapav fer sa, mo pou gagn problem avek li » ou « mo pa kone si mo fami pou soutenir mwa ».
Ces peurs sont légitimes et rendent le départ très difficile. Matériellement, certaines personnes dépendent financièrement de leur partenaire, ou n’ont pas de logement ou de soutien familial immédiat. Cela crée une vraie barrière. Du coup, même si elles veulent partir, elles ne peuvent pas le faire sans mettre en danger leur sécurité ou celle de leurs enfants.
Pourquoi est-ce si difficile de sortir d’une relation toxique ?
Ce qui rend une relation toxique si difficile, même quand la victime en est consciente, c’est la combinaison de plusieurs facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux. D’abord, il y a l’emprise émotionnelle. Même en sachant que la relation est toxique, la personne reste attachée à son partenaire à cause de l’alternance entre moments d’affection et moments de conflit.
Une fois de plus, à Maurice, on entend souvent : « Li kapav fer mwa sourir, mo pa kapav kit li pou sa » - ces petits moments de « bon côté » renforcent la dépendance affective.
Ensuite, il y a la culpabilité et la peur. Beaucoup de victimes ont été conditionnées à croire qu’elles sont responsables de la situation ou qu’elles doivent « tenir » pour le bien du couple ou de la famille : « Si mo kit li, ki pou arive mwa ? »
Et finalement, il y a la perte de confiance en soi. L’emprise et les critiques constantes font douter de ses perceptions et de ses décisions.
Comment accompagner quelqu’un qui veut partir, mais se sent piégé ?
D’abord, il faut créer un espace sécurisant où la personne peut parler librement de ses peurs et de sa situation. Ensuite, on peut aider à établir un plan concret pour sécuriser le départ : repérer des personnes de confiance, préparer des ressources financières, identifier des lieux sûrs, et parfois contacter des associations ou des services d’aide locaux. À Maurice, certaines structures comme les centres sociaux ou des ONG peuvent fournir soutien et hébergement temporaire.
Enfin, l’accompagnement implique un soutien psychologique continu. La personne doit reconstruire sa confiance en elle et son autonomie émotionnelle, car quitter une relation toxique n’est pas seulement un acte physique, c’est aussi un processus émotionnel. On encourage à avancer pas à pas, à respecter son rythme, et à renforcer son réseau de soutien.
Une fois la relation rompue, comment amorcer la reconstruction ?
Dans un premier temps, il est essentiel de reconnaître ce qui a été vécu : la personne peut mettre des mots sur ses émotions, comprendre les mécanismes d’emprise, et identifier les blessures psychologiques laissées par la relation. Ensuite, reconstruire son estime de soi est clé.
Cela peut passer par de petites victoires du quotidien, la reprise d’activités qui font plaisir, ou le renforcement du réseau social avec des personnes de confiance. Il est aussi souvent très utile d’avoir un accompagnement psychologique professionnel pour traiter les traumatismes et éviter de reproduire les mêmes schémas dans de futures relations.
Enfin, la reconstruction inclut la redécouverte de sa liberté et de son autonomie. La personne apprend à poser des limites, à écouter ses besoins, et à se reconnecter à ce qui lui fait du bien. Cela peut prendre du temps, mais chaque pas, même petit, est une avancée vers la résilience.
Quels types d’accompagnement sont les plus bénéfiques ?
Le type d’accompagnement le plus bénéfique dépend beaucoup de la situation et des besoins de la personne. Souvent, une combinaison de plusieurs approches fonctionne le mieux. La psychothérapie individuelle est essentielle pour permettre à la victime de parler librement, de comprendre les mécanismes de l’emprise et de reconstruire sa confiance en elle.
Les groupes de parole sont aussi très bénéfiques, car ils permettent de se sentir moins seule et de partager son expérience avec d’autres qui ont vécu des situations similaires. Cela peut réduire la honte et la culpabilité, et montrer que ce qui est vécu n’est pas normal, même si beaucoup le minimisent autour de nous.
La médiation familiale peut être utile dans certains cas, surtout quand il y a des enfants ou des enjeux de cohabitation, mais il faut l’utiliser avec prudence. Si la violence ou l’emprise est encore présente, une médiation peut parfois être contre-productive. On privilégie alors d’abord la sécurité et le soutien individuel.
Comment les proches peuvent-ils aider sans juger ?
Les proches doivent apprendre à valider les émotions, même s’ils ne comprennent pas entièrement la situation. Il est aussi important de ne pas presser la personne à agir. On ne peut pas « forcer quelqu’un à quitter une relation », surtout si elle se sent piégée ou dépendante. Le rôle des proches est d’offrir du soutien, de partager des ressources (psychologue, groupes de parole, associations locales) et de rester présents, sans jugement.
Quel message souhaitez-vous adresser à celles et ceux qui doutent, mais sentent que « quelque chose ne va pas » ?
Mon message est simple : faites confiance à vos ressentis. Votre instinct est souvent le premier indicateur que la relation n’est pas saine. Ne minimisez pas ce que vous ressentez et n’attendez pas que la situation s’aggrave pour chercher du soutien. Parlez à quelqu’un de confiance, qu’il s’agisse d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un professionnel.
Il est important de se rappeler que l’amour ne doit jamais faire peur, faire douter de soi ou isoler. Même si c’est difficile, il est possible de se protéger, de reprendre confiance en soi et de retrouver sa liberté. Vous n’êtes pas seule, et demander de l’aide n’est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage.
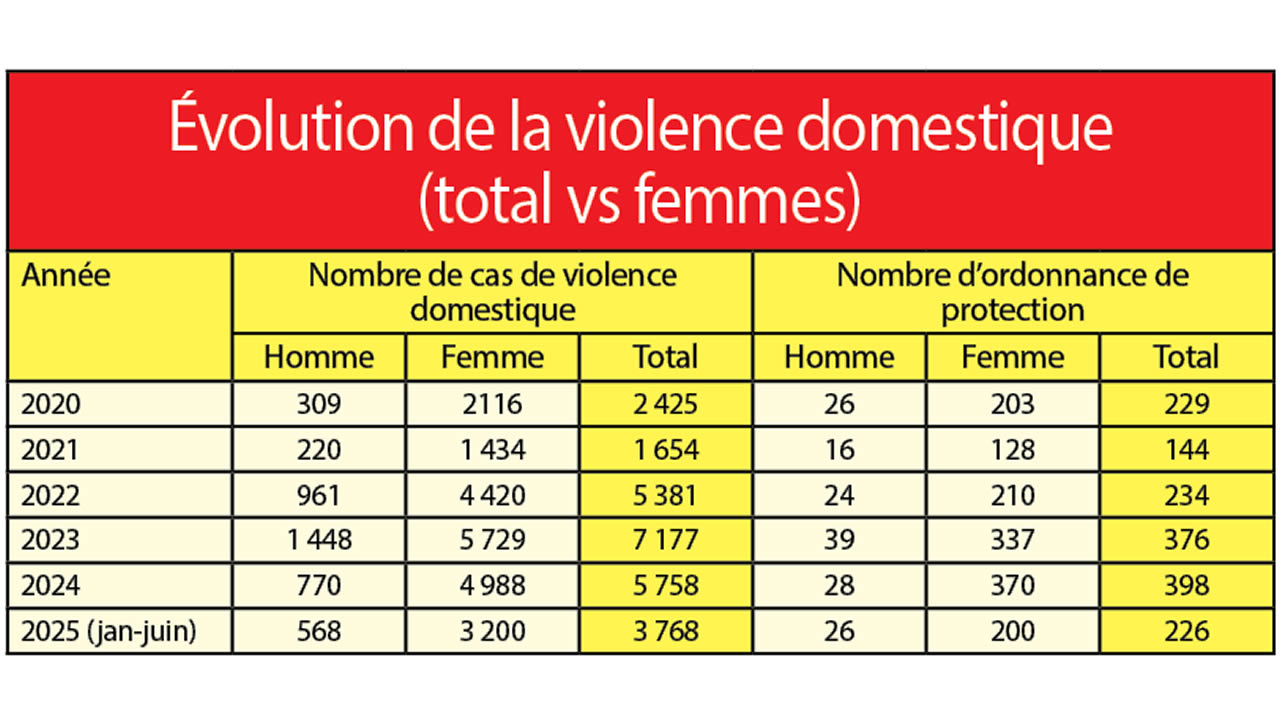
Des conseils sur TikTok
La psychologue Fatimah Ghanty est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, à travers son compte @fatimah_psychologist. Elle y compte plus de 100 000 abonnés (100,8K) et cumule plus de 2,2 millions de « likes ». Elle y partage régulièrement des vidéos dans lesquelles elle décrypte des situations de la vie quotidienne et propose des conseils psychologiques accessibles à tous.
Les trois signes clés d’une relation toxique
La perte de confiance en soi. La personne doute constamment de ses choix et de ses perceptions. À Maurice, on entend souvent : « Mo pa kone si mo pe exazere » ou « Mo zis pe fer erer », ce qui montre que l’emprise l’a fait douter d’elle-même.
Le contrôle et l’isolement. Le partenaire tente de limiter les contacts avec la famille, les amis ou les réseaux sociaux, sous prétexte de « protection » : « Mo zis pa oule to zwenn sa dimounn-la, li move pou twa. » L’isolement est un signe très fort que la relation devient malsaine.
Les critiques constantes et la manipulation émotionnelle. Cela inclut culpabilisation, menaces voilées, alternance entre affection et rejet. Les phrases comme : « Si to kontan mwa, to pou fer sa » ou « Si to pa fer sa, mo pou tris », montrent que l’amour est utilisé comme moyen de contrôle, et non comme un soutien.








