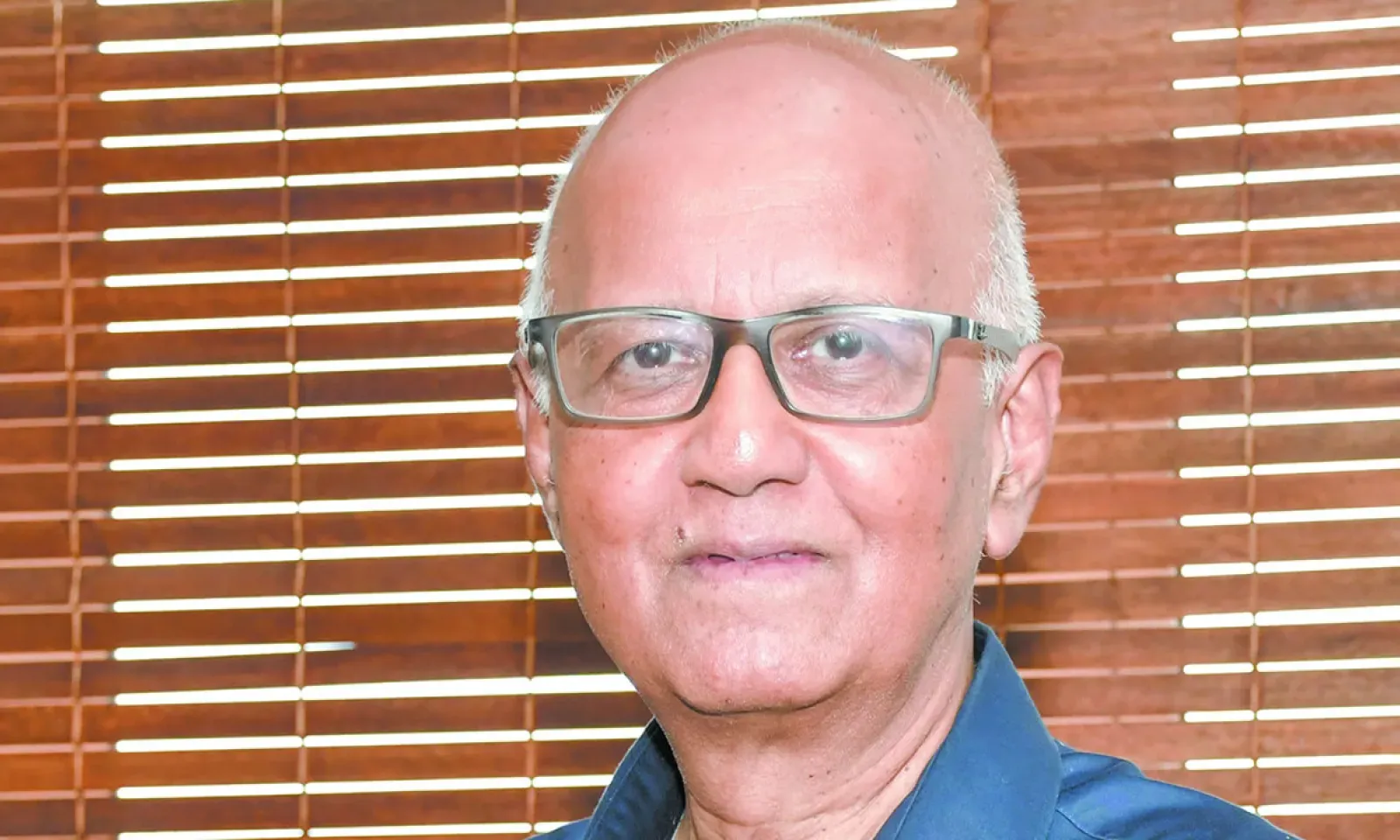
À Maurice, le mérite reste un idéal fragile. Le Dr Om Nath Varma décrypte comment privilèges, réseaux et biais influencent opportunités et réussite, et propose des pistes pour une vraie équité.
« Si la société veut récompenser l’effort et le talent plutôt que les relations, les pratiques injustes doivent être activement corrigées »
Pensez-vous que la méritocratie soit vraiment un idéal universel, ou est-ce plutôt une construction sociale et culturelle ?
La méritocratie est souvent présentée comme un idéal universel, mais elle est en réalité une construction sociale. Chaque société définit et privilégie certains groupes considérés comme possédant des qualités vues comme idéales.
« Si la méritocratie est utilisée comme un idéal, la réalité est qu’elle masque souvent les inégalités et renforce l’élitisme sous couvert d’équité »
Le sociologue Michael Young a inventé le terme de « méritocratie » dans son livre The Rise of the Meritocracy (1958). Il soutenait que si la société considère le succès comme basé sur le « mérite », alors les gagnants en viendront à croire qu’ils méritent pleinement leur position, tandis que les perdants seront blâmés pour leur propre échec. Les gagnants développeront un certain degré d’arrogance, convaincus de leur supériorité.
Un certain degré d’arrogance imprègne notre société. Nous ne sommes pas prêts à remettre en question le système éducatif hypercompétitif, toujours prêts à considérer certaines écoles et collèges comme idéaux pour nos enfants. Sommes-nous conscients que le bonheur réside dans le fait que davantage de personnes soient récompensées pour leurs compétences et talents ? Sans doute, la valeur que nous attachons aux compétences dépend de ce qu’elles rapportent sur le marché.
Tout cela crée ce que Young décrit comme une « arrogance cachée de supériorité » : ceux qui sont au sommet se sentent justifiés de regarder les autres de haut, convaincus d’être « naturellement » plus talentueux ou travailleurs. Pendant ce temps, ceux qui sont exclus des opportunités se voient dire qu’ils manquent simplement de mérite, même lorsque leurs désavantages découlent d’inégalités sociales : mauvais enseignement, réseaux limités ou biais systémiques.
Si la méritocratie est utilisée comme un idéal, une façon de dire que chacun a une chance équitable, la réalité est qu’elle masque souvent les inégalités et renforce l’élitisme sous couvert d’équité.
« Il existe une ‘mobilité sponsorisée’ subtile qui passe inaperçue, voire considérée comme normale »
Justement, peut-on vraiment parler de méritocratie sans considérer le milieu social et les privilèges ?
La vérité est que le mérite n’est jamais mesuré sur un terrain équitable. Bien avant qu’une personne passe un examen ou postule un emploi, son milieu familial a déjà façonné ses chances.
Le sociologue Pierre Bourdieu expliquait que les familles ne transmettent pas seulement de l’argent ; elles transmettent aussi des compétences linguistiques, des goûts culturels, de la confiance face à l’autorité et des réseaux sociaux. Les écoles et les employeurs considèrent souvent ces avantages hérités comme du « talent » ou de la « capacité », alors qu’il s’agit en réalité de privilèges.
Un autre sociologue, Max Weber, a souligné que les groupes d’élite protègent leurs avantages par des mécanismes comme des diplômes exclusifs, des associations professionnelles ou des clubs sociaux. Ces mécanismes excluent silencieusement les autres. Ainsi, certaines personnes commencent la course avec une avance, soutenues par ce que l’on pourrait appeler un échafaudage invisible.
Lorsque la société célèbre les résultats comme étant uniquement le fruit du « mérite », sans reconnaître ces avantages cachés, elle en vient à considérer le privilège comme « normal » et bénéfique pour la société. En d’autres termes, la méritocratie récompense souvent non seulement l’effort et la capacité, mais aussi les ressources inégalement distribuées dont les individus disposent dès la naissance.
Existe-t-il des formes de mérite que la société néglige, et pourquoi ?
Absolument. Tous les types de talent ne sont pas remarqués ou récompensés. Prenons, par exemple, le soin des autres, la gestion des émotions ou l’aide à résoudre des conflits – des compétences que la sociologue Arlie Hochschild, dans son livre Stolen Pride, appelle « travail émotionnel ». Ces compétences sont vitales dans les familles, les communautés et même sur le lieu de travail, mais elles sont rarement reconnues au même titre que les résultats scolaires ou le succès financier.
Nous attachons de la valeur aux gains utilitaires, oubliant que réduire les maux de la société passe par la résolution des problèmes émotionnels, et que les personnes qui accomplissent ces tâches sont rarement reconnues
Ce qui compte comme « mérite » varie également selon la culture et le pouvoir. Dans certains endroits, l’esprit entrepreneurial est célébré ; dans d’autres, l’obéissance ou un haut niveau d’éducation peut être la clé du succès. Mais des qualités comme la résilience, l’empathie ou la créativité passent souvent inaperçues car elles ne correspondent pas à l’idée dominante de réussite. Le problème n’est donc pas que ces capacités n’existent pas, mais que nos systèmes ne sont pas conçus pour les valoriser.
Ainsi, lorsque nous parlons de « mérite », nous ne parlons pas vraiment d’une notion universelle.
Comment les jeunes vivent-ils ces contraintes dans l’éducation ou le travail ?
Les jeunes grandissent en entendant le même message : « Si tu travailles dur, tu réussiras. » Mais beaucoup réalisent rapidement que ce n’est pas toujours vrai.
Prenons les stages non rémunérés ou très peu rémunérés. Dans de nombreuses industries, environ 40 % des stages dans les entreprises à but lucratif ne sont pas payés, mais ils sont considérés comme essentiels. Sur le papier, ce sont des opportunités d’acquérir de l’expérience, mais en réalité, seuls les étudiants issus de familles aisées peuvent se permettre de travailler gratuitement.
Ou considérez les emplois qui relèvent constamment les exigences : il faut un diplôme, puis un master, puis des années d’expérience. Pourtant, les opportunités reviennent toujours à ceux qui ont le bon nom de famille ou les bonnes connexions, ce que les sociologues appellent « le réseau des anciens élèves ».
Les sociologues décrivent cela comme une « mobilité à courte portée ». C’est comme grimper une échelle pour découvrir que les derniers barreaux manquent. Peu importe vos efforts, l’étape suivante est hors de portée.
Ainsi, bien que la promesse de la méritocratie semble équitable, beaucoup de jeunes sentent que le jeu est déjà truqué avant même de pouvoir y participer.
« Lorsque les systèmes sont perçus comme justes et transparents, la motivation augmente. Les gens travaillent plus dur, font davantage confiance à leurs institutions »
Quelle est l’influence de la reconnaissance inégale du mérite sur la motivation et l’engagement ?
Elle peut être décourageante. Imaginez travailler dur, consacrer des heures, faire tout « correctement » et voir quelqu’un d’autre obtenir la promotion grâce à des liens familiaux ou des connexions. Lorsque l’effort et le talent ne se traduisent pas par des récompenses équitables, les individus se sentent naturellement désillusionnés et sous-évalués. Certains perdent même leur sens du but au travail.
Les études montrent que l’injustice diminue la motivation et réduit la performance. Les travailleurs qui se sentent négligés sont plus susceptibles de se désengager, de cesser de donner le meilleur d’eux-mêmes ou même de quitter leur emploi. Dans certains cas, les gens émigrent pour trouver des lieux où leurs compétences seront mieux reconnues, contribuant au phénomène dit de « fuite des cerveaux ».
Mais le contraire est également vrai. Lorsque les systèmes sont perçus comme justes et transparents – promotions, bourses ou récompenses basées clairement sur la contribution plutôt que sur le favoritisme –, la motivation augmente. Les gens travaillent plus dur, font davantage confiance à leurs institutions et sont fiers de faire partie du système.
Sommes-nous là ? De nombreux événements semblent indiquer le contraire. Est-ce parce que la population éduquée a augmenté plus rapidement que la création d’emplois correspondant aux qualifications ? Ainsi, certaines institutions éducatives sponsorisées par des entreprises trouvent plus facilement des placements et des opportunités pour leurs diplômés. Il existe une « mobilité sponsorisée » subtile qui passe inaperçue, voire considérée comme normale.
À Maurice, quelles règles ou habitudes non écrites façonnent le succès ?
À Maurice, comme dans de nombreux petits pays, réussir ne dépend pas seulement du talent ou du travail acharné. Cela dépend souvent de choses non écrites : l’école fréquentée, les relations, et parfois même le nom de famille. Ce ne sont pas des règles officielles, mais elles comptent beaucoup.
On remarque rapidement que certaines connexions, comme une recommandation de la bonne personne ou une introduction au bon réseau, peuvent ouvrir des portes que l’effort seul ne suffirait pas à franchir. C’est comme s’il existait un guide invisible indiquant qui progresse réellement. Les voies officielles, comme les examens ou les candidatures, existent, mais en pratique, les raccourcis informels et les réseaux personnels déterminent souvent qui obtient les opportunités les plus importantes. En bref, qui vous connaissez peut être aussi important que ce que vous savez.
« En pratique, les raccourcis informels et les réseaux personnels déterminent souvent qui obtient les opportunités les plus importantes »
Dans quelle mesure les biais inconscients, comme le genre, la classe ou les réseaux, freinent-ils les individus ?
Nous disposons de peu de recherches sur ces questions à Maurice, mais nous pouvons parler de ce qui se passe généralement. Les biais fonctionnent souvent discrètement, sans que l’on s’en rende compte. Par exemple, un homme qui s’exprime avec assurance au travail peut être qualifié de « leader », tandis qu’une femme disant la même chose peut être étiquetée « agressive ».
Les personnes issues de milieux moins privilégiés peuvent être considérées comme « inadaptées », même lorsqu’elles sont tout aussi compétentes que les autres. À Maurice, même lorsque l’on plaide pour la valorisation du créole, la capacité à parler français couramment compte dans de nombreux contextes.
Les réseaux jouent également un rôle : quelqu’un qui connaît les bonnes personnes peut sembler plus compétent simplement parce qu’il est familier ou bien connecté, et non nécessairement parce qu’il est meilleur dans son travail. Ces biais ne sont généralement pas intentionnels, mais ont des conséquences réelles : ils bloquent les opportunités, ralentissent les carrières et découragent parfois les gens de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Les liens familiaux et les réseaux masquent-ils le potentiel ou créent-ils un succès artificiel ?
Les deux peuvent se produire. D’un côté, connaître les bonnes personnes, par la famille, les amis ou les réseaux sociaux, peut donner à quelqu’un des opportunités qu’il n’a pas méritées par ses compétences. Un emploi, un contrat ou une promotion peut lui être accordé simplement à cause de ses relations, créant un succès sponsorisé où quelqu’un semble compétent parce qu’on lui a donné la chance.
De l’autre, cela signifie que le véritable talent passe souvent inaperçu. Les personnes sans les bonnes connexions peuvent ne jamais obtenir la visibilité ou les opportunités qu’elles méritent, peu importe leur capacité.
Les réseaux ne sont pas intrinsèquement mauvais ; ils peuvent aider les gens à se soutenir, mais lorsqu’ils remplacent la compétition équitable, il devient difficile de distinguer qui a réellement mérité son succès et qui a bénéficié du privilège.
Pourquoi certaines personnes talentueuses quittent-elles Maurice, ce qui conduit au phénomène de la fuite des cerveaux comme vous l’avez mentionné plus tôt ?
Beaucoup partent parce qu’elles veulent que leurs compétences et leur travail soient reconnus, ce qui n’arrive parfois pas chez elles. Si les salaires plus élevés sont une raison, un facteur plus important est souvent la justice et les opportunités. À l’étranger, elles peuvent trouver des systèmes où l’effort est récompensé de manière plus fiable et où la promotion ou la progression dépend des compétences, non des relations ou de la politique.
Si les systèmes locaux semblent lents, biaisés ou fermés aux nouveaux venus, il paraît plus facile de construire une carrière significative ailleurs. Pour beaucoup, partir n’est pas un rejet de Maurice, mais une recherche de respect, de reconnaissance et de la possibilité d’exploiter pleinement leurs talents. En résumé, la fuite des cerveaux se produit lorsque le talent se sent sous-évalué à domicile et que des opportunités existent ailleurs pour être reconnu.
Le mérite est-il plutôt un idéal ou une réalité à Maurice ?
À Maurice, la méritocratie est davantage un idéal qu’une réalité. Sur le papier, le système semble équitable. Il existe des examens compétitifs, des bourses et des processus de recrutement ouverts. Mais dans la vie quotidienne, beaucoup estiment que le mérite est souvent éclipsé par les biais, les relations ou le favoritisme.
Cela crée un écart entre la promesse de la méritocratie et ce que les gens vivent réellement. La plupart des Mauriciens croient encore que le travail acharné et le talent devraient conduire au succès, mais beaucoup sont sceptiques quant à sa concrétisation dans les écoles, les entreprises ou la fonction publique. Cependant, le problème ne doit pas être considéré uniquement dans le cadre des emplois publics. En pratique, de nombreuses personnes rencontrent des obstacles, du favoritisme et des biais qui limitent les opportunités.
En d’autres termes, le mérite est célébré comme valeur, mais il ne correspond pas toujours à la réalité. La méritocratie est un objectif auquel nous aspirons, mais la réalité est souvent plus complexe.
Quelles conditions permettraient l’existence d’une véritable méritocratie à Maurice ?
Pour que la méritocratie fonctionne réellement à Maurice, plusieurs changements seraient nécessaires. Tout d’abord, les systèmes doivent être transparents. Les emplois, promotions et bourses devraient être basés sur des critères clairs et équitables, avec des protections contre les biais, le favoritisme ou les liens familiaux.
L’éducation est également essentielle. Les élèves de tous horizons devraient avoir des chances égales de réussir, et pas seulement ceux qui peuvent se permettre des cours privés ou un soutien supplémentaire.
Il faut aussi élargir la définition du mérite. Il ne devrait pas se limiter aux résultats d’examens ou aux relations personnelles. Des qualités comme le travail en équipe, la contribution à la communauté, la créativité et la résilience devraient également compter.
Enfin, il doit y avoir de véritables conséquences pour le favoritisme. Si la société veut récompenser l’effort et le talent plutôt que les relations, les pratiques injustes doivent être activement corrigées.
En résumé, une véritable méritocratie serait juste, transparente, inclusive et reconnaîtrait tous les types de talent, pas seulement ceux qui sont les plus faciles à mesurer.
Nous avons besoin de leaders capables de montrer l’exemple. Il existe encore l’impression que notre rêve d’une société véritablement méritocratique n’est pas pour un avenir proche. Aucun pays n’est idéal. Mais un effort réel doit être fait pour aller au-delà des critiques exprimées depuis des années, avec peu de réponses positives jusqu’à présent. Nous ne devons pas oublier que cette société a été construite grâce au travail acharné de nombreuses personnes et institutions souvent passées inaperçues.
À moins d’apprendre à célébrer et valoriser ces personnes et institutions, nous risquons de ne pas trouver les repères pour rester unis en tant que peuple et nation.








