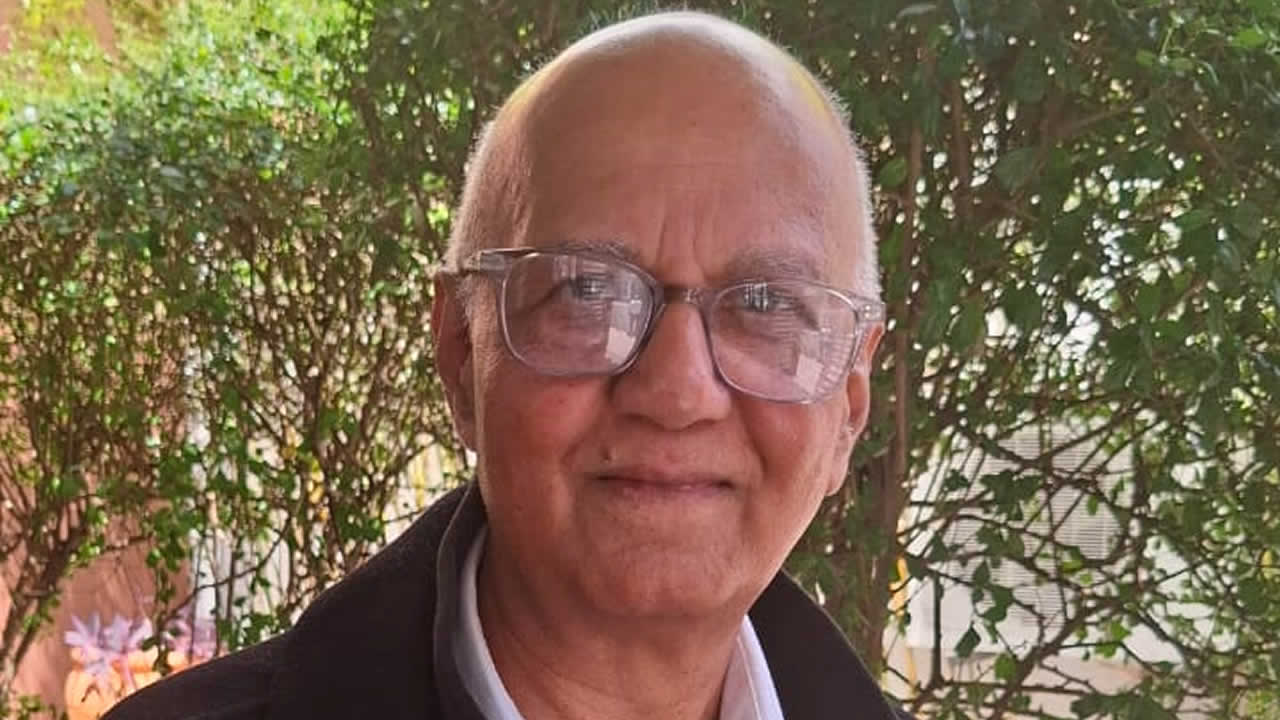
Face à la hausse des drames routiers, le sociologue Dr Oomandra Nath Varma analyse le basculement de la société mauricienne, passée de la résignation à une indignation collective.
Qu’est-ce qui a changé dans la société mauricienne pour qu’on passe de la résignation à la révolte face aux accidents mortels ?
Pendant des années, ces tragédies étaient accueillies avec résignation – un malheur regrettable mais accepté comme faisant partie du quotidien. Aujourd’hui, on observe une indignation collective et des protestations publiques. Ce changement est enraciné dans une évolution sociale majeure : une frustration croissante face à la perte répétée de jeunes vies, une confiance en déclin envers les institutions, et une prise de conscience que nombre de collisions mortelles ne sont pas des fatalités, mais des événements évitables provoqués par des comportements imprudents.
La colère publique reflète la perception que la négligence au volant, souvent liée à la vitesse, à l’alcool ou aux drogues, s’est normalisée. Lorsque des usagers de la route adoptent sciemment des comportements qui mettent autrui en danger, de nombreux Mauriciens considèrent désormais ces actes comme moralement proches d’une violence intentionnelle.
Le commentaire du ministre Osman Mahomed, affirmant que certains comportements ressemblent à une « préméditation de meurtre », trouve écho parce qu’il exprime ce que beaucoup ressentent : qualifier ces événements de simples « accidents » masque leur caractère évitable.
La pression publique en faveur de lois plus strictes ne procède pas d’un désir de répression excessive, mais de la frustration face à l’inertie institutionnelle.
Comment les réseaux sociaux (Facebook, TikTok…) et la viralité des images d’accidents ont-ils transformé le rapport des Mauriciens à la sécurité routière et à la mort sur la route ?
La numérisation de l’indignation a également modifié la relation des Mauriciens à la sécurité routière. Facebook, TikTok et d’autres plateformes ont démocratisé la diffusion d’images d’accidents, donnant naissance à une forme de « journalisme populaire » où des citoyens ordinaires documentent des scènes autrefois invisibles. Les images virales créent une proximité émotionnelle : le public n’est plus face à des statistiques abstraites, mais à des corps, à la douleur et au chaos.
Cependant, la viralité est éphémère. Pour qu’un changement durable de comportement émerge, il faut plus qu’une indignation numérique passagère : il faut une mobilisation organisée et continue. La colère liée à la sécurité routière est souvent épisodique, ne s’enflammant qu’après une tragédie majeure. Cela limite la profondeur de la réflexion collective et empêche de transformer l’émotion en véritable réforme.
Le slogan « Nou kont bann sofer kriminel », scandé lors de la marche organisée par le Mouvement pour la sécurité et la justice routière, traduit-il un état d’esprit collectif ?
Ce slogan révèle une évolution profonde du vocabulaire moral. Il exprime un jugement collectif ancré dans l’expérience quotidienne : demandez à n’importe quel Mauricien, il pourra raconter plusieurs rencontres avec des conducteurs imprudents, des courses sauvages ou des excès de vitesse habituels. Cette normalisation du risque crée un climat où la colère paraît légitime.
Mais la société envoie des signaux contradictoires. Des événements comme le rallye de Port-Louis, largement célébré, mettent en avant l’agilité et l’habileté des jeunes conducteurs – tout en soulevant des questions. Comment ces jeunes acquièrent-ils une telle maîtrise dans un pays presque dépourvu d’infrastructures pour la conduite rapide ? Sans circuits dédiés et encadrement très limité, ces compétences proviennent souvent de pratiques informelles, voire illégales. En valorisant de tels spectacles, on risque de légitimer les mêmes comportements que l’on condamne.
La pression publique en faveur de lois plus strictes ne procède pas d’un désir de répression excessive, mais de la frustration face à l’inertie institutionnelle. Lorsque les citoyens perçoivent une application de la loi faible, incohérente ou politiquement biaisée, ils recourent au langage moral pour exiger une réaction plus rapide.
Si les excès de vitesse, les dépassements téméraires et les règles piétonnes ignorées sont la norme, ils s’inscrivent dans la culture commune»
Que signifie sociologiquement le passage du vocabulaire de la fatalité (« accident ») à celui de la responsabilité (« crime ») ? Simple ajustement linguistique ou révolution culturelle ?
Sociologiquement, le passage du terme fatalité (« accident ») à celui de responsabilité (« crime ») marque plus qu’un changement linguistique : c’est le début d’une redéfinition culturelle de la violence routière. De plus en plus de Mauriciens rejettent l’idée que toutes les collisions relèvent du hasard. Beaucoup comprennent que les accidents mortels résultent de schémas prévisibles : vitesse, fatigue, intoxication, dépassements dangereux ou défaillances infrastructurelles.
Pourtant, la réticence historique de l’État à appliquer des mesures strictes a aussi façonné ces perceptions. Certains partis politiques ont parfois assoupli les sanctions pour conduite dangereuse, éliminé le permis à points, ou signalé les emplacements des radars, décisions alors bien accueillies par le même public qui réclame aujourd’hui plus de sévérité. Les contradictions sont évidentes : la culture du « Mr Break », glorifiée pour contourner les contrôles policiers, coexiste avec les appels à la justice pour les victimes.
Malgré les milliards investis dans les caméras Safe City, les gouvernements ont hésité à les utiliser systématiquement pour contrôler la vitesse – un outil pourtant capable de réduire drastiquement les comportements dangereux. Parallèlement, le marquage routier, les limitations de vitesse et les infrastructures piétonnes restent souvent en deçà des normes des grandes villes.
Les pratiques quotidiennes aggravent la situation : bus et vans roulant à vive allure, piétons traversant sans précaution, processions occupant la chaussée pendant des heures avec la complicité des forces de l’ordre. Ces comportements façonnent collectivement ce que la société considère comme « normal » sur la route.
En réalité, la conduite dangereuse ne persiste pas par manque d’éducation, mais parce que les gens apprennent de leur environnement social. Les normes se transmettent par observation : si les excès de vitesse, les dépassements téméraires et les règles piétonnes ignorées sont la norme, ils s’inscrivent dans la culture commune. La persuasion et les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à contrer des comportements renforcés quotidiennement par l’expérience vécue.
Transformer la culture routière mauricienne exige donc bien plus que du blâme ou des vagues d’indignation. Il faut une cohérence structurelle dans l’application de la loi, du courage politique et une redéfinition de ce qui est socialement acceptable. Ce n’est que lorsque la prudence deviendra la norme visible, pratiquée par les aînés, les institutions et les conducteurs, que la sécurité pourra faire partie de l’identité sociale du pays.
Qualifier quelqu’un de « criminel » pour un acte routier : un stigmate social ?
Évidemment, il peut s’agir d’un stigmate. Mais les stigmates peuvent aussi jouer un rôle dissuasif. Dans toutes les sociétés, ils servent de mécanisme puissant de contrôle social lorsque le dialogue et des moyens plus doux ont échoué. Le stigmate fonctionne comme un mécanisme informel qui contribue à freiner la hausse des accidents mortels en façonnant les comportements à travers les normes collectives.
S’inspirant de Durkheim, qui considère que la société réagit à la déviance pour réaffirmer ses valeurs partagées, la désapprobation publique de la conduite dangereuse, alcool au volant, vitesse excessive ou dépassements risqués, trace une frontière morale entre « usagers responsables » et « contrevenants dangereux ». Cette frontière est renforcée par la notion de stigmate chez Goffman : une « identité dégradée » que les individus craignent d’endosser.
La théorie de l’étiquetage suggère que ces labels stigmatisants fonctionnent comme un frein : on évite des comportements susceptibles de nous faire catégoriser comme « conducteurs criminels ». Ainsi, lorsque la société condamne collectivement la conduite dangereuse, la crainte du déshonneur incite à l’autodiscipline.
Les jeunes, et même les adultes, ne changent pas leurs comportements parce qu’on leur répète qu’il faut ‘faire attention’»
Cette criminalisation répond-elle réellement aux besoins des familles endeuillées ou reste-t-elle surtout symbolique ?
La criminalisation répond partiellement aux besoins des familles endeuillées, mais demeure largement symbolique. D’un côté, la sanction pénale représente une reconnaissance institutionnelle importante : elle affirme que la vie de la victime comptait et qu’un tort grave a été commis. Pour certaines familles, tenir le responsable punissable restaure un sentiment de dignité et valide publiquement leur souffrance.
Mais cette forme de justice ne répond pas aux besoins émotionnels ou relationnels plus profonds. Aucune condamnation ne peut apaiser la douleur, réparer le lien perdu ou offrir un soutien durable. Beaucoup de familles décrivent la sanction pénale – même sévère – comme insuffisante, car elle ne touche pas à la dimension humaine de leur perte. Elle se concentre sur l’individu fautif, alors que les familles espèrent souvent une reconnaissance plus large : solidarité communautaire, meilleures infrastructures, prévention renforcée.
En ce sens, la criminalisation est un geste symbolique de condamnation sociale, mais elle ne constitue pas une réponse complète. Elle offre une justice formelle, mais laisse ouvertes de nombreuses blessures.
Que révèle notre comportement au volant sur notre rapport aux règles, à l’autorité et aux autres ?
Notre conduite automobile est un miroir révélateur de notre rapport aux règles, à l’autorité et à autrui. Certains perçoivent les règles comme un bien commun qui protège tout le monde, d’autres les considèrent comme des contraintes négociables.
Elle révèle aussi notre relation à l’autorité : ceux qui respectent la loi, même sans surveillance, témoignent d’une discipline internalisée ; ceux qui obéissent seulement en présence de policiers réagissent davantage par crainte que par conviction.
Enfin, notre conduite expose la manière dont nous percevons les autres : prudence et respect traduisent un sens du collectif ; agressivité et imprudence reflètent un individualisme qui place l’intérêt personnel avant la sécurité d’autrui.
Pourquoi certains comportements à risque sont-ils banalisés, et pourquoi l’entourage ou les passagers ne s’y opposent-ils pas ?
Cette banalisation repose sur une combinaison de facteurs culturels, psychologiques et sociaux. Dans certaines cultures, l’alcool est associé à la fête ou à la virilité, et la vitesse à la compétence ou au courage. À force d’être observés sans conséquence, ces actes perdent leur gravité apparente.
La psychologie joue aussi un rôle : excès de confiance, illusion de contrôle, habitude d’être « passé entre les mailles » renforcent une fausse impression de sécurité.
Les dynamiques de groupe contribuent à ce silence : peur de créer un conflit, volonté de préserver l’harmonie, hiérarchie sociale au sein du groupe. On préfère éviter d’humilier le conducteur. S’y ajoute la diffusion de responsabilité : chacun espère que quelqu’un d’autre interviendra. Résultat : la normalisation de comportements risqués s’installe, et le silence devient complicité.
Le passage du terme fatalité (‘accident’) à celui de responsabilité (‘crime’) marque plus qu’un changement linguistique : c’est le début d’une redéfinition culturelle de la violence routière»
Quel rôle jouent les ventes de boissons alcoolisées dans la responsabilité morale et sociale des accidents ? Existe-t-il une culture du « service responsable » à Maurice ?
Le lien entre alcool et accidents est bien connu, mais le rôle des vendeurs d’alcool reste largement absent du débat national. Si les conducteurs sont juridiquement responsables, les commerces qui profitent de la vente d’alcool portent aussi une responsabilité morale.
À l’étranger, la culture du « service responsable » est devenue une norme : formation du personnel, interdiction de servir les clients déjà ivres, alternatives de transport. En Australie ou au Canada, ces pratiques sont obligatoires.
À Maurice, cela n’existe pratiquement pas. Il n’y a ni cadre national, ni formation obligatoire, ni lignes directrices claires. Beaucoup d’établissements privilégient le chiffre d’affaires : promotions agressives, offres illimitées, happy hours prolongés. Refuser un client ivre est perçu comme une perte financière, non un devoir civique.
Pour développer une véritable culture du service responsable, Maurice aurait besoin d’une stratégie coordonnée : formation obligatoire, normes nationales, régulation des promotions dangereuses, partenariats avec les transporteurs. La prévention ne commence pas uniquement avec le conducteur : les vendeurs d’alcool sont des acteurs clés.
Comment passer d’une logique punitive à une logique préventive sur les routes ?
Maurice a privilégié la punition, amendes, retrait de points – qui semble refaire surface –, suspensions, mais ces mesures arrivent souvent trop tard. La prévention doit commencer dès l’enfance, avec une meilleure éducation routière, et se poursuivre par un accompagnement renforcé des jeunes conducteurs, permis probatoire, restrictions temporaires.
La prévention implique aussi de meilleures infrastructures : signalisation claire, éclairage, voiries plus sûres, ralentisseurs, espaces piétons sécurisés. Elle exige de s’attaquer aux risques à leur source : alcool, fatigue, vitesse, distraction, et de promouvoir le service responsable dans les établissements nocturnes.
Les communautés, entreprises et écoles doivent aussi jouer un rôle, tout comme les technologies embarquées. L’objectif : passer d’une culture de la peur à une culture de la responsabilité partagée.
Quels leviers sociaux peuvent transformer durablement les comportements dangereux sans ostraciser une génération de conducteurs ?
Transformer les comportements ne nécessite pas de blâmer une génération entière. Le changement vient de leviers sociaux. Un changement culturel : valoriser la conduite calme, respectueuse et responsable ; utiliser des modèles positifs (athlètes, artistes, figures locales). Un changement communautaire : initiatives dans les écoles, villages, groupes de jeunes ; messages entre pairs.
Un changement éducatif, apprendre par l’expérience plutôt que par la peur, est probablement la meilleure option que je voudrais élaborer pour mieux comprendre.
Pour transformer durablement la culture routière mauricienne, il devient clair que les campagnes moralisatrices ne suffisent plus. Les jeunes, et même les adultes, ne changent pas leurs comportements parce qu’on leur répète qu’il faut « faire attention », mais lorsqu’ils vivent eux-mêmes l’expérience du risque, lorsqu’ils ressentent dans leur corps ou dans leur émotion ce que des slogans ne peuvent transmettre. C’est dans cette logique qu’un véritable changement éducatif s’impose, fondé sur trois outils complémentaires : les ateliers pratiques, les simulateurs de conduite, et les témoignages des secouristes.
Les ateliers pratiques offrent un premier contact essentiel avec la réalité du danger. Sur un parcours sécurisé, un jeune peut par exemple tester une distance de freinage et mesurer concrètement la différence entre un arrêt à 40 km/h et un arrêt à 80 km/h. Rien ne marque autant l’esprit que de voir la voiture continuer sa course sur plusieurs mètres alors qu’on croyait avoir « freiné à temps ».
Dans d’autres ateliers, on apprend à éviter un obstacle soudain, à porter les premiers gestes de secours, ou encore à ressentir, grâce à des lunettes spécialisées, les effets de l’alcool ou de la fatigue sur la perception. Ce sont des exercices simples mais puissants : ils font passer la sécurité routière du domaine de l’abstraction à celui de l’expérience vécue.
Les simulateurs de conduite prolongent cette pédagogie sans danger. Dans un environnement immersif, un jeune conducteur peut affronter une pluie battante, perdre momentanément l’adhérence de la route, ou encore constater l’impact d’une distraction de deux secondes. Ce « laboratoire du risque » permet d’observer ses erreurs, de les analyser et de les corriger immédiatement. Dans plusieurs pays, ces simulateurs sont désormais une étape incontournable du processus d’apprentissage, car ils développent des réflexes et une conscience des risques que la théorie seule ne peut inculquer.
Enfin, les témoignages de secouristes apportent une dimension humaine et émotionnelle impossible à reproduire autrement. Quand un pompier ou un ambulancier raconte comment il a dû extraire un jeune blessé, rassurer une famille en détresse, ou intervenir sur une scène encore marquée par la violence d’un choc, le message prend chair. Il ne s’agit plus de statistiques, mais de vies, de visages, de blessures. Cette approche ne vise pas à faire peur, mais à provoquer l’empathie qui pousse à se sentir responsable, à comprendre que chaque geste sur la route a des conséquences réelles sur des personnes réelles.
En combinant ces trois leviers – l’expérience physique, l’immersion contrôlée et la parole humaine –, on ne transmet plus seulement des règles : on façonne une culture de la sécurité. C’est sans doute par ce type d’éducation active et innovante que Maurice pourra, à long terme, transformer la relation de ses citoyens à la route, et rompre avec la normalisation dangereuse de la vitesse, de la négligence et du fatalisme.
Le changement durable repose sur une culture de respect mutuel et de responsabilité partagée, plutôt que sur la culpabilisation.








